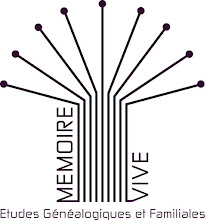Le généathème du mois de septembre tombe à pic. Voila bientôt cinq ans que le Blog de Mémoire vive existe et la question de sa pertinence, du moins dans sa forme actuelle se pose à moi depuis de nombreuses semaines. Je n'ai d'ailleurs rien publié depuis le mois de mai dernier. Il m'est arrivé par le passé d'avoir des passages à vide, mais là c'est une traversée du désert.
J'aimerais bien trouver une nouvelle formule, un nouveau format, une autre façon d'aborder la généalogie. Je m'interroge également sur le contenu.
Quand je relis les raisons pour lesquelles j'ai créé ce blog, (que vous pouvez lire dans ce premier billet daté de décembre 2010), je me dis qu'elles sont toujours valables. La généalogie est une matière qui se prête au partage tant des méthodes que des anecdotes de recherches, que des histoires elles-mêmes. J'avais envie d'ancrer la généalogie dans le monde d'aujourd'hui, ne pas tomber dans la nostalgie facile, d'essayer d'aborder cette matière de manière vivante, enthousiaste et surtout de la relier à d'autres matières : l'histoire bien entendu, mais aussi la photo, la littérature, la sociologie, la psychologie.
Mais j'avoue que depuis quelques temps je suis un peu perdue ; je ne sais plus trop bien quoi penser ni écrire. Ma généalogie est en berne depuis des mois, si bien que je ne reconnais plus mes ancêtres. J'avoue également avoir frôlé l'overdose de lecture de blogs et de billets, sans parler de la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale. Loin de moi l'idée de remettre en cause les blogs généalogiques existants : la démarche est sincère et les billets dans leur ensemble sont intéressants. De plus je crois profondément à la notion de partage des histoires et des difficultés rencontrées : la généalogie est un travail solitaire et publier sur un blog permet de sortir de cet isolement.
Maintenant, j'ai l'impression d'être arrivée au bout de mes publications et à chaque brouillon de billet résonne en moi le "à quoi bon" de démotivation. J'imagine que je suis arrivée au bout de ce format et qu'il faut que j'en invente un autre. Peut-être plus court, plus concis, plus interactif, je ne sais pas encore. J'aime ce qui fait écho,ce qui éveille en nous une petite musique. C'est cela que j'aimerais mettre en avant. Je dis souvent à mes clients que l'important n'est pas forcément de remonter le plus loin possible (excepté pour les personnes qui le veulent dès le départ) mais d'essayer d'avoir des résultats qui nous parlent, qui font que nous puissions nous identifier à tel ou tel ancêtre, ou du moins qui provoquent en nous un intérêt, quel qu'il soit.
Voilà trois années que je travaille pour un couple de personnes qui a sollicité mes services pour dans un premier temps établir leur arbre généalogique. Une fois arrivé à la Révolution française, ils ont estimé qu'ils en savaient assez. En revanche, ils ont continué à me faire travailler sur leurs cousins : d'un seul coup leur curiosité se portait sur tel ou tel cousin de leur connaissance et/ou de leur génération et ils se posaient alors la question de savoir quel était leur ancêtre commun. Et c'est ainsi que leur arbre s'est étoffé.
L'idée n'est pas de publier à tout prix; l'idée est de susciter l'intérêt, la curiosité, l'appétence.
Par conséquent, je pense que jusqu'à ce que ma "nouvelle formule" soit prête, je vais piocher dans la centaine de billets déjà écrits et remettre en avant ceux qui sont passés, injustement à mon sens, inaperçus.
A suivre donc...
Réflexions et découvertes d'une généalogiste professionnelle, passionnée par l'histoire des individus, de leur famille et de leur époque.
mercredi 30 septembre 2015
vendredi 29 mai 2015
Le métier de généalogiste expliqué aux enfants
Au début du mois de mai j'ai accepté l'invitation de l'association des parents d'élèves qui organise chaque année le forum des métiers pour les classes de CM1-CM2 dans l'école de ma fille. Une heure vingt pour présenter le métier de généalogiste familial à un public de 30 enfants (oui les classes sont nombreuses dans cette école...) en présence de leur professeur.Vrai challenge en ce qui me concerne, je ne suis pas à l'aise en présence d'un auditoire, je n'ai pas la parole facile ; l'écrit est mon mode privilégié de communication ; déjà à la période de la fac, les exposés me mettaient à la torture.
Mais bon, j'ai grandi (ou au moins vieilli) et je maîtrise mieux mon sujet du jour que les sujets d'exposés imposés de l'époque. De plus, c'est toujours un privilège de pouvoir faire partager ce que l'on aime.
L'intervention devait se dérouler en deux temps : la présentation du métier et l'animation d'un atelier mettant les enfants en situation. Forte de ces instructions communes à tous les participants, je me suis mise au travail. J'ai d'abord rédigé toute une série de questions afin de créer une interaction avec les enfants et je leur ai proposé ensuite de construire un arbre généalogique à partir d'actes soigneusement choisis par mes soins, puisque le généalogiste professionnel travaille sur d'autres généalogies que la sienne.
C'est le premier temps de l'intervention qui sera l'objet de ce billet.
Les questions de départ :
- savez vous ce qu'est un généalogiste ?
- avez-vous entendu parler de la généalogie ?
Quelques-uns maîtrisaient bien le sujet ; d'autres avaient déjà commencé leur sieste en ce début d'après-midi. Il faut dire que commencer ma présentation après l'heure de cantine, dans une salle de classe au rideaux tirés pour permettre une utilisation maximale du rétroprojecteur n'est pas l'atmosphère la plus stimulante pour des enfants...
Parmi les enfants "actifs", certains m'ont parlé d'une émission télé pour retrouver les personnes disparues, d'autres m'ont parlé des rois de France, d'autres d'adoption, d'enfants abandonnés...
Histoire de mettre tout le monde d'accord et de savoir de quoi nous allions parler, j'ai donné une définition de la généalogie comme matière qui a pour objet la recherche de l'origine des familles et l'étude de sa composition. Je leur ai demandé quels étaient les mots qui leur semblaient importants dans cette définition : "famille" est arrivé en premier ; "recherche" en second. Je pense qu'ils ont parfaitement compris.
J'ai donc expliqué que le métier de généalogiste consistait à faire des recherches. J'avais pris le parti d'axer mon discours sur cette idée en employant volontairement un vocabulaire propre aux histoires policières : enquête, indices, pistes, déduction, investigation. J'ai essayé pour les plus férus de science-fiction de parler de machine à remonter le temps ; l'accueil a été plutôt bon. Les enfants ont été accrochés par cette approche.
J'ai ensuite parlé de l'arbre généalogique en montrant des exemples : là encore adhésion complète. L'arbre synthétise et illustre à lui seul la matière.
Ensuite, j'ai essayé de recenser avec eux quelles informations on allait rechercher : la première réponse qui m'a été donnée m'a fait sourire : la date de la mort... Nombre d'enfants (dont je faisais partie) commencent toujours les histoires par la fin... D'autres réponses ont fusé : les adresses, les métiers, les numéros de téléphone... Alors on a remis toutes ces réponses dans l'ordre : nom, prénom, date et lieu de naissance, nom des parents, lieu de résidence profession, union ou non, enfants, frères et soeurs, décès le cas échéant.
Je leur ai expliqué qu'en croisant ces données, nous allions voir se dessiner petit à petit les contours d'une personne et en savoir plus sur ses conditions de vie, son entourage etc. J'ai associé l'image à un pop-up, et là encore, j'ai vu que beaucoup d'entre eux avaient saisi l'idée. D'autres continuaient leur sieste réparatrice...
Après, je leur ai demandé comment ils s'y prendraient pour faire ces recherches, à qui ils iraient demander. A nos parents ? Leur premier réflexe m'a semblé excellent : il n'y a rien de tel pour commencer que d'interroger ses proches sur l'état de leurs connaissances en matière d'ancêtres. Je leur ai dit que c'était la première chose que je demandais aux personnes qui venaient solliciter mes services : ce qu'ils savaient et s'ils avaient à leur disposition des papiers de famille. On a passé en revue quels pouvaient bien être ces papiers : certains m'ont parlé de livret scolaire, d'autres d'ordonnances du médecin... Certains encore, peut-être plus habitués à faire des démarches administratives avec leurs parents m'ont tout de suite parlé du livret de famille.
On a donc convenu que tout papier contenant un indice biographique était important car cela allait nous amener à l'état civil. Nouvel échange alors sur ce qu'est l'état civil, son rôle, à savoir consigner sur des registres les évènements importants de la vie sociale d'une personne ; je leur ai demandé lesquels ? encore une fois la première réponse a été la mort... oui, certes, mais avant ça ? La naissance ! et je crois que j'en ai étonné plus d'un en leur disant qu'ils avaient tous un acte de naissance.
J'ai terminé cette partie en parlant des autres sources d'information : les recensements, les archives militaires, les cadastres, etc.
Les enfants ont fait preuve de beaucoup d'attention et sont intervenus bien volontiers. J'ai conclu cette première partie par l'aspect plus éloigné de la généalogie mais plus ancré dans le réel : comment devient-on généalogiste ?
Je leur ai surtout fait part de ma propre expérience, des joies mais aussi des difficultés propres à ce type d'activité indépendante et commerciale. Je leur ai parlé de mon site, du blog et des réseaux sociaux. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont retenu de cette partie, mais ce n'est pas bien grave, car ce n'était pas la plus intéressante pour des enfants de cet âge.
Mais bon, j'ai grandi (ou au moins vieilli) et je maîtrise mieux mon sujet du jour que les sujets d'exposés imposés de l'époque. De plus, c'est toujours un privilège de pouvoir faire partager ce que l'on aime.
L'intervention devait se dérouler en deux temps : la présentation du métier et l'animation d'un atelier mettant les enfants en situation. Forte de ces instructions communes à tous les participants, je me suis mise au travail. J'ai d'abord rédigé toute une série de questions afin de créer une interaction avec les enfants et je leur ai proposé ensuite de construire un arbre généalogique à partir d'actes soigneusement choisis par mes soins, puisque le généalogiste professionnel travaille sur d'autres généalogies que la sienne.
C'est le premier temps de l'intervention qui sera l'objet de ce billet.
Les questions de départ :
- savez vous ce qu'est un généalogiste ?
- avez-vous entendu parler de la généalogie ?
Quelques-uns maîtrisaient bien le sujet ; d'autres avaient déjà commencé leur sieste en ce début d'après-midi. Il faut dire que commencer ma présentation après l'heure de cantine, dans une salle de classe au rideaux tirés pour permettre une utilisation maximale du rétroprojecteur n'est pas l'atmosphère la plus stimulante pour des enfants...
Parmi les enfants "actifs", certains m'ont parlé d'une émission télé pour retrouver les personnes disparues, d'autres m'ont parlé des rois de France, d'autres d'adoption, d'enfants abandonnés...
Histoire de mettre tout le monde d'accord et de savoir de quoi nous allions parler, j'ai donné une définition de la généalogie comme matière qui a pour objet la recherche de l'origine des familles et l'étude de sa composition. Je leur ai demandé quels étaient les mots qui leur semblaient importants dans cette définition : "famille" est arrivé en premier ; "recherche" en second. Je pense qu'ils ont parfaitement compris.
J'ai donc expliqué que le métier de généalogiste consistait à faire des recherches. J'avais pris le parti d'axer mon discours sur cette idée en employant volontairement un vocabulaire propre aux histoires policières : enquête, indices, pistes, déduction, investigation. J'ai essayé pour les plus férus de science-fiction de parler de machine à remonter le temps ; l'accueil a été plutôt bon. Les enfants ont été accrochés par cette approche.
J'ai ensuite parlé de l'arbre généalogique en montrant des exemples : là encore adhésion complète. L'arbre synthétise et illustre à lui seul la matière.
Ensuite, j'ai essayé de recenser avec eux quelles informations on allait rechercher : la première réponse qui m'a été donnée m'a fait sourire : la date de la mort... Nombre d'enfants (dont je faisais partie) commencent toujours les histoires par la fin... D'autres réponses ont fusé : les adresses, les métiers, les numéros de téléphone... Alors on a remis toutes ces réponses dans l'ordre : nom, prénom, date et lieu de naissance, nom des parents, lieu de résidence profession, union ou non, enfants, frères et soeurs, décès le cas échéant.
Je leur ai expliqué qu'en croisant ces données, nous allions voir se dessiner petit à petit les contours d'une personne et en savoir plus sur ses conditions de vie, son entourage etc. J'ai associé l'image à un pop-up, et là encore, j'ai vu que beaucoup d'entre eux avaient saisi l'idée. D'autres continuaient leur sieste réparatrice...
Après, je leur ai demandé comment ils s'y prendraient pour faire ces recherches, à qui ils iraient demander. A nos parents ? Leur premier réflexe m'a semblé excellent : il n'y a rien de tel pour commencer que d'interroger ses proches sur l'état de leurs connaissances en matière d'ancêtres. Je leur ai dit que c'était la première chose que je demandais aux personnes qui venaient solliciter mes services : ce qu'ils savaient et s'ils avaient à leur disposition des papiers de famille. On a passé en revue quels pouvaient bien être ces papiers : certains m'ont parlé de livret scolaire, d'autres d'ordonnances du médecin... Certains encore, peut-être plus habitués à faire des démarches administratives avec leurs parents m'ont tout de suite parlé du livret de famille.
On a donc convenu que tout papier contenant un indice biographique était important car cela allait nous amener à l'état civil. Nouvel échange alors sur ce qu'est l'état civil, son rôle, à savoir consigner sur des registres les évènements importants de la vie sociale d'une personne ; je leur ai demandé lesquels ? encore une fois la première réponse a été la mort... oui, certes, mais avant ça ? La naissance ! et je crois que j'en ai étonné plus d'un en leur disant qu'ils avaient tous un acte de naissance.
J'ai terminé cette partie en parlant des autres sources d'information : les recensements, les archives militaires, les cadastres, etc.
Les enfants ont fait preuve de beaucoup d'attention et sont intervenus bien volontiers. J'ai conclu cette première partie par l'aspect plus éloigné de la généalogie mais plus ancré dans le réel : comment devient-on généalogiste ?
Je leur ai surtout fait part de ma propre expérience, des joies mais aussi des difficultés propres à ce type d'activité indépendante et commerciale. Je leur ai parlé de mon site, du blog et des réseaux sociaux. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont retenu de cette partie, mais ce n'est pas bien grave, car ce n'était pas la plus intéressante pour des enfants de cet âge.
dimanche 10 mai 2015
D'une expo à l'autre
Alors que vient de s'ouvrir à Milan l'exposition universelle de 2015, je vous re- propose une balade en photos dans celle de Paris de 1937. Ces clichés ont été pris par les arrière-grands parents de mes enfants, qui étaient parisiens et venaient comme tant d'autres visiter cet extraordinaire rendez-vous que le monde se donnait à Paris, juste deux ans avant que n'éclate le second conflit mondial. Bonne visite !
Où l'on voit le pavillon soviétique et le pavillon de l'Allemagne nazie se faire face.
____________________________________________________
Sept clichés, sept trésors découverts dans un album de photos de famille, témoignages visuels du rendez-vous de Paris avec le monde. Point de vue de simples visiteurs, munis de leur appareil photos et qui vont immortaliser ce moment . Soixante-quinze années plus tard, ces clichés nous parviennent.
L'exposition internationale s'est tenue à Paris de mai à novembre 1937.
Elle s'étendait sur plus de 100 hectares, où 52 pays étaient représentés à travers différents pavillons. Plus de 30 millions de visiteurs parmi lesquels nos photographes.
Elle s'étendait sur plus de 100 hectares, où 52 pays étaient représentés à travers différents pavillons. Plus de 30 millions de visiteurs parmi lesquels nos photographes.
©Dardaud
©Dardaud
Où l'on voit le pavillon soviétique et le pavillon de l'Allemagne nazie se faire face.
©Dardaud
Le palais du Trocadéro a été détruit, le palais de Chaillot le remplace.
©Dardaud
Les pavillons des provinces.
©Dardaud
©Dardaud
©Dardaud
_____________________________________________________________
Pour d'autres photos :
Inscription à :
Articles (Atom)